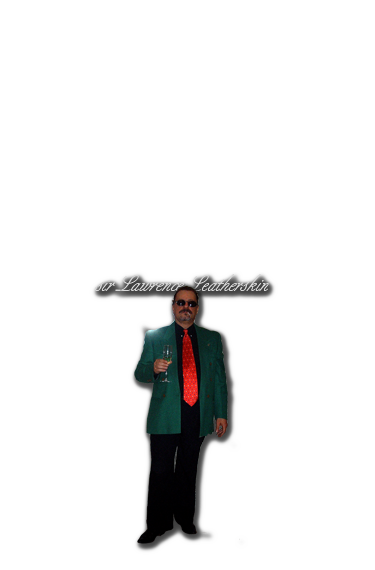Rencontre avec Laurent Pellecuer
« Un gentleman n’essaie pas de se faire connaître
et laisse cela aux petits égoïstes parvenus. »
H-P.Lovecraft
À Marseille, Belle de Mai, au troisième et dernier étage d’un immeuble qui abritait jadis les ouvriers de l’usine Seita (aujourd’hui transformée en un de ces centres d’art où l’art se meurt), résistant dans son atelier privé à l’hégémonie des intermittents vénaux et autres larbins de l’état décultureur, vit Laurent Pellecuer. Le quartier est bruyamment cosmopolite : aux beuglements méridionaux des locaux répondent les aboiements nord-africains, sur un fond de borborygmes négroïdes qu’entrecoupent les agressifs accents catalans des indomptables gitans sédentarisés. C’est ainsi que le mélange ethnico-culturel mijoté par les bonnes consciences de nos gouvernants dans les latrines médiatico-ministérielles, commence démocratiquement dans le brouhaha insensé de Babel, avant de se résoudre matériellement et physiologiquement en une sous- race métèque. Le mélange systématique de tout et tout le monde ne profite à personne ; la disparition de l’altérité signifie celle de l’humanité. J’avais les oreilles toutes irritées de ce salmigondis bigarré lorsque je pénétrais dans l’atelier du peintre, où je fus accueilli par les grincements mélodieux du violon de Jasha Heifetz, qui interprétait la « Chaconne » de Johann-Sébastien Bach. L’actuelle civilisation en son stade fort avancé de dissolution restait plantée sur le palier et l’individu hirsute qui me reçut n’avait rien d’un plagiste à brevet de secourisme. Le bonhomme, pour le moins, est bedonnant et arborait un sourire sincèrement gêné. Il était anachroniquement vêtu d’une robe de chambre bleueâtre qui le ferait ressembler à Paul Léautaud ou à Céline, s’il n’avait eu le ventre du Père-Noël. Il se déplace du pas pesant et laborieux de qui dort trop, fatigué par sa propre paresse. Durant notre entretien, qu’il mène avec un accent bâtard, mi-vauclusien, mi héraultais, il roule des cigarettes qui s’éteignent en permanence et qu’il rallume sans cesse, comme pour être toujours en train de fumer, et qui entraînent sur leur fin des quintes de toux écœurantes se terminant en nausées ; il s’éclipse alors poliment, rend de la bile on ne sais où, et revient les yeux larmoyants, le visage écarlate, s’excusant sans conviction et se mouchant d’une manière répugnante dans un mouchoir raide de glaire séchée. La signature de qui vit en asocial, comme en attesteraient la montagne de linge sale et la vaisselle aux reliefs moisissants, que je soupçonnais dans son appartement, juste en face de l’atelier, sur le même palier. Sous ses ongles mal taillés, une lisière noirâtre dénote d’une hygiène douteuse, impression confirmée de son propre aveu et par ses dents jaunies sous l’absence de confrontation à la brosse, ou bien les traces noirâtres sur son col de chemise. A l’évidence, Pellecuer n’obéit pas aux lois désinfecteuses de la contemporanéité. Au début de notre entretien, il m’offrît un excellant café, venu directement, dit-il, du Mexique. Plus après, lorsqu’approcha le midi, il nous servît une bière Belge d’abbaye au nom anglais francisé, épaisse et fort goûteuse, que nous bûmes, la conversation allant son train, avec une ardeur croissante. Charcuteries et fromages n’empêchèrent pas les brumes inhérentes à l’immodération, d’emplâtrer nos palais, embalbutier nos discours et alourdir gravement nos pensées. Si bien qu’à la fin, c’est-à-dire tard dans l’après-midi, le dialogue tellement réservé et courtois du début, sombra dans de graveleuses considérations sur l’activité sexuelle du Français, comparée à l’idée surdimensionnée qu’il se fait de son intellect et du rayonnement artistique de sa nation mitée… en même temps, et au fur et à mesure, arrivaient ceux qu’il aime ou ceux qu’il n’aime pas, ceux qu’il tolère et ceux qu’il accueille, et tout ce joli monde y allait de ses opinions, comme en une démocratie en manque de cellule de soutient psychologique…
ENTRETIEN :
Sir Lawrence Leatherskin :
Laurent James vous suggère, je cite : « de clore définitivement l’histoire de la peinture », par « un portrait en pied de Jean-Pierre Foucault ». Quand allez-vous vous y mettre ?
Laurent Pellecuer :
Jamais… Non que cette idée qu’a Laurent de me faire « portraiturer les grands de ce monde » ne soit pas charmante ; mais surtout, je n’ai aucune envie de « clore définitivement l’histoire de la peinture ». Bien plutôt de la continuer, j’aimerais reprendre l’histoire de l’art où l’ont laissée les modernes, les « contemporains » et autres « post-modernes », et sauter par dessus, autant que faire se peut.
Vous rêvez ! Ne savez-vous pas que notre époque en a fini avec toute forme d’histoire ?
Plût au Ciel que fut vrai, je serais le premier à me réjouir de la fin de notre civilisation, de toute civilisation et de l’humanité en général ; mais j’ai bien peur que nous en ayons encore pour un moment… « Le cadavre bouge encore ».
Est-ce ce que vous exprimez dans votre œuvre, ou du moins ce que vous voulez exprimer ?
Je ne vois pas l’intérêt qu’il y a à exprimer quelqu’opinion par l’art. L’opinion, c’est pour les diseurs, ceux qui fabriquent de grosses bédées, ou qui écrivent plusieurs tomes afin d’expliquer que le rien qu’ils exhibent n’est pas le néant, mais : « un vide actif qui porte une signature, une chose qui fait sens, môdâme… » Comprenez que je ne suis pas un adepte de l’événementiel. Je laisse les happening à ceux qui se sentent engagés dans leur époque, alors qu’ils n’en sont que les résidus, parce qu’ils imaginent que suivre benoîtement un mouvement de mode, se conformer – ou non - aux idéologies dominantes, improviser sur l’air du temps, c’est être à la pointe de l’avant garde et du progrès. Alors, oui, si une chose est finie, c’est l’art des avant-gardes. Après les révolutions et tous leurs avatars dans le domaine de la pensée, il faut inventer d’autres moyens pour extraire l’âme de son carcan de boue, explorer plus avant ce qui peut élever l’homme au dessus de la bête et que les deux derniers siècles n’ont pas su détruire. Je crois qu’il y a encore du sacré dans l’art, peut-être pas au sens le plus élevé que recouvre ce terme, cependant un facteur sur-humain si il n’est plus effectivement divin.
Vous semblez considérer l’art comme une sorte de religion ?
Ce n’est pas cela. Une religion est un corps constitué, un lien entre les hommes, une communauté, que l’on appelle communion, sous-tendue par une aspiration qui les dépasse et qui est chargée de régler au mieux les différents aspects de l’existence. L’art n’est rien de tout ceci, il s’apparente plutôt à la prière, c’est d’ailleurs ce qu’il est à l’origine. Sa fonction est d’éclairer, il n’est pas créateur, il révèle le réel, il dévoile la création à la créature. C’est Adam qui nomme ce qui s’offre à son entendement, qui amène à l’existence ce qui n’est qu’en puissance.
Vous voulez dire qu’il rend visible l’invisible ?
Ce serait prétentieux. Non, ce que je veux dire c’est qu’il l’exprime (bien que je déteste ce mot) il définit en un temps donné et dans un espace donné, les conditions d’existence d’une réalité particulière, en ce qui concerne la peinture : le visible, l’apparent. L’art est descriptif, il décrit ce que Léon Daudet, je crois, recouvrait sous la notion d’ambiance, le milieu formateur de la personne et au sein duquel évolue l’individu.
Ne croyez-vous pas cependant que l’art sacré se situe au-delà de l’aspect purement descriptif ? Ne craignez-vous pas d’assimiler l’Icône à l’image sulpicienne, pour faire bref ?
Bien entendu. Mais je ne parlais pas de l’art sacré. L’art sacré est la forme première et la plus aboutie de tout art. La musique naît de la Liturgie, au commencement elle est la Liturgie ; de la même manière, l’Icône participe du rite tandis que la peinture constitue une sortie de l’enceinte sacrée, elle s’adresse à l’homme commun, à la créature sociale. Ceci ne veut pas dire pour autant qu’elle soit un objet d’agrément, elle est ce que la philosophie est à la théologie. L’art sacré est une forme supérieure de l’art et ne diminue en rien les qualités propres à l’art profane, leur fonction est différente.
Vous disiez tout à l’heure que l’art était « sur-humain », or vous le ramenez maintenant à du « tout-humain » ; n’y a-t-il pas contradiction ?
Contradiction… ma foi ! c’est humain, la contradiction. L’artiste dont je parle est censé regrouper en lui l’ensemble de ce qui fait l’humain, l’humanité de l’humain. Dans votre locution, le premier terme est « tout », c’est à dire aussi « sur », parce qu’en se plaçant au-delà, l’artiste aura une vision intégrale, il donnera une vue d’ensemble, plus sure. Une manière de dépasser la contradiction. Cela se voit, par exemple, dans la manière qu’ont certains peintres d’unir les contrastes, de les heurter ou de les lier, en staccato ou legato, comme en une symphonie où une phrase est répétée de plusieurs manières pour constituer un tout. Pour le peintre, cette totalité est le tableau, un monde refait en dimensions réduites, un événement décrit avec son avant et son après, un ensemble physique complet, une image où ne survit pas cette contradiction, sinon l’ouvrage s’écroule. Un peu comme en architecture il faut respecter certaines règles, bien que pour nous, peintres, elles ne soient qu’un accord tacite, une loi que l’on peut transgresser dans une certaine mesure, si l’on décide d’en suivre d’autres.
Nous en venons donc à des considérations matérielles, à savoir votre œil, celui que vous portez sur la réalité sensible. Aujourd’hui, pour louer les artistes, quelle que soit leur spécialité, on dit d’eux qu’ils ont « vraiment leur univers personnel, un monde qui n’appartient qu’à eux » ; votre monde, quel est-il ? Quelles sont ses lois ?
Je décèle quelqu’ironie dans cette question, n’est ce pas ? Pour parler crûment, vous vous foutez de ma gueule !
Je m’en voudrais…
Bien… peu me chaud ! Mais si nous devons sombrer dans la vulgarité, allons-y ! Cette fable d’univers particuliers est une invention d’imbéciles nombrilistes, ceux qui prétendent les créer autant que ceux qui prétendent en percer les mystères pour les dévoiler aux regards abrutis d’un public infantile. La création n’appartient qu’au Seul Créateur, à Dieu, point final. L’égoïsme vaniteux des blagueurs contemporains leur inspire des théories vaporeuses, telles que ce mensonge délirant d’univers parallèles auxquels ils accèdent en transes artistiques, ces dieux auxquels on s’adresse directement, sans intermédiaire, et qui ont la bassesse de nous répondre. Ce chemin les mène droit à l’idolâtrie de l’art, ou de « l’intelligence ».(Peut-être parce qu’ils en sont dépourvus, d’intelligence, qu’ils l’adorent comme ce « dieu inconnu » de la décadence grecque.)
Cette « intelligence » est bien sur un succédané de ce qui mérite ce nom, quelque chose comme un dictionnaire de citations que l’on ne comprend pas, un recueil d’oracles chaldaïques qui ne disent rien, mais auxquels on fait tout dire ; de même que l’art vénéré est l’art de masse, massif et lourd, l’art du poids. Pour se grandir soi-même, on valorise l’infime, on fait d’un gravillon une montagne, un humain d’une rognure d’ongle, un monde de l’hallucination. Parce que l’on est plus capable d’appréhender l’univers en tenant compte des infinis cosmiques et de l’infiniment petit, produits des sciences qui n’auraient jamais dues êtres données à tous, source du vertige que donnent ces savoirs sans fin, distribués en parts aléatoires pour ne l’être jamais en totalité ; parce que l’on ne sait plus accepter l’incompréhensible, on voudrait se fabriquer un petit univers à soi, en ramassant de la mousse et en y plantant des santons, et présenter ce jardin japonais comme étant un monde entier dont on serait le démiurge créateur. C’est en niant la réalité concrète que l’on arrive à croire dur comme fer à de fumeux mensonges, que l’on élabore cette escroquerie dont nous sommes les premiers dupes. Il faut fermement croire à son propre mensonge pour le faire avaler aux autres, d’où la complicité évidente qui existe entre l’artiste et son critique, qui fait que le second appuie l’erreur du premier et que le public suit tout ce joli monde dans l’abîme. Je ne parle bien sur ici que de la caste dominante ou médiatique, car un certain nombre de voix semblent s’élever pour démolir ces fictions.
Vous êtes donc optimiste ?
Si vous continuez vos provocations, notre discussion s’arrêtera là !
… Je vous demande pardon… J’aimerais que nous parlions de détails plus terre à terre, voulez-vous ? Savoir, par exemple, si vous dessinez avant de peindre, ou bien si vous attaquez directement avec vos pinceaux et vos couleurs sur la toile ?
Je n’aime pas trop parler de ma cuisine, je ne veux pas que l'on entre dans ma chambre à coucher. Cela n’ajoute rien à la compréhension d’une œuvre et même, ça l’encombre de futilités et ça nuit à une réelle acception du travail effectué. C’est assez facile de raconter comment à tel endroit on a posé un rouge particulier à coté du bleu profond qu’il y avait et réveillé grâce à un jaune de Naples la lumière que l’on avait éteinte ; le résultat compte seul. D’ailleurs, ces choses là son visibles, vous n’avez qu’à ouvrir les yeux et réfléchir si vous avez du temps à perdre. Puis en vous le racontant je serai obligé de mentir, ne serait-ce que par omission.
Je songeais plutôt à vous interroger sur les valeurs respectives que vous accordez au dessin ou à la peinture.
Ah bon ? Excusez-moi, je n’avais pas saisi le sens de votre question...
La différence réside selon moi, en ce que le dessin est une abstraction, tandis que la peinture est une matérialisation. Je m’explique : Rouault dit que « le dessin est un jet de l’esprit en éveil », Delacroix préconise de « dessiner un ouvrier qui tombe de son échafaudage » ; tous les deux nous parlent d’une situation d’immédiateté, d’un mouvement rapide, tant d’exécution que de vision. En effet, je crois qu’un dessin doit être vif, spontané, c’est-à-dire qu’il procède d’une impulsion, il est le nerf qui tend le muscle, le cœur qui envoie le sang. La peinture, matière et couleur, est le muscle lui-même, tendu ou au repos, la chair, au pire le vêtement. Pour paraphraser un certain proverbe, la peinture est le flacon, le dessin l’ivresse. A votre première proposition, je répondrais que l’un est indissociable de l’autre, quand « j’attaque directement avec mes pinceaux et mes couleurs sur la toile », je commence de toute façon par dessiner, sinon il n’y a que des taches et des dégoulinades sans signification. J’accorde beaucoup d’importance au sujet et à la manière de le représenter.
Vous ne vous intéressez pas à la peinture abstraite ?
Disons qu’elle a souvent d’indéniables vertus décoratives : des assiettes décorées par Kandinsky sur une nappe Mondrian, ce serait très joli dans une cantine d’H.L.M.(et je n’ai pas pris les pires ! ) ; malgré tout, il est des œuvres abstraites qui parlent, je pense à celles de Pollock. Je me trompe peut-être, mais il me semble que tout ce qu’il a fait était étonnement figuratif, bien que n’en ayant pas l’apparence. Cela vient de ce que ses œuvres sont très dessinées, on voit toujours qu’il a voulu dépeindre une réalité visible, quelque chose comme des feuilles mortes en automne avec leurs nervures et le vent qui les emporte, ou le tas qu’elles forment et que l’on piétine. Je dis qu’il dessine parce que chez lui, la vie est là sans cesse, l’ouvrier de Delacroix et l’esprit de Rouault. C’est un exemple d’abstraction réussie.
Je me suis essayé à ces machins en faisant mes « Arbres », plus précisément, j’ai tenté d’exprimer la sensation romantique d’intemporalité telle que l’on peut la ressentir à deux moments de la journée qui sont l’aurore et le crépuscule, quand il n’est ni jour ni nuit, entre chien et loup, entre l’ombre de la nuit où plus rien ne se voit et la lumière aveuglante de l’aube où l’on voit trop. C’est-à-dire lorsque le monde est irréel, cet instant où l’on voit plus ce que l’on veut que ce qui est, où tout ce qui est possible est visible et vice versa. J’étais obsédé par l’idée du chaos en tant que réalité en voie d’ordonnance. Le vide pris comme une pleinitude à venir… je lisais beaucoup Gérard de Nerval : « Les premier instants du sommeil sont l’image de la mort. » Je dois avouer que je me trompais sur à peu prés tout. On m’a beaucoup félicité de mes cadres de bois brut (Qui étaient très mignons, mais l’idée n’était pas de moi.), et on ne portait pas grand intérêt, à juste titre, au sujet lui-même, trop décoratif à mon goût.
Vous vouliez tout de même décrire une certaine réalité telle que vous la voyiez à ce moment là, ou telle que vous l’imaginiez ?
Certes, mais c’était une erreur, je le répète : cette entreprise était de toute façon vouée à l’échec. Rendre une vision personnelle du réel n’est que vanité, orgueil et à la fin ennui. Je me fiche de savoir si Vlaminck rêvait en peignant des sous bois enflammés par le soleil couchant, de même que le ciel n’entre en convulsion que dans mon œil quand je vois une nuit étoilée de Van Gogh. L’artiste doit combattre simultanément l’orgueil et la possession, comprendre que la nature n’est pas sienne et qu’il n’est pas naturel. L’artifice est notre métier, réaliser l’illusion. Pour cela, nous nous libérons de l’instinct par l’art et ses règles. Les tentatives qui ont été faites pour faire peindre des animaux, chimpanzés, chats et autres, nous montrent que ceux-ci n’élaborent que des œuvres abstraites, or les enfants nous donnent à voir des choses concrètes, à partir du moment où ils ont acquis l’usage de la raison. Ce qui veut dire que l’activité artistique naît de l’éducation et de la raison, parce qu’elle obéit à des lois que nous nous employons à découvrir, qui sont aussi les conditions de survie de notre espèce. On demande à un enfant : « Qu’est-ce que tu as dessiné ? », pas à un chat, ni à un chimpanzé.
Vous me faites penser à Hitler pour qui l’Allemagne ne méritait pas de survivre si elle perdait la guerre. Cela semble être ce que vous pensez de l’humanité, qu’elle ne mérite pas de survivre, à moins de gagner la guerre qu’elle livre à la nature, ou à l’instinct ?
C’est excessif et faux. Je ne suis sur de rien, mais je crois que l’humanité ne survivra pas en se laissant entraîner dans la pente qu’elle a choisi de suivre, non qu’elle mérite quoi que ce soit. En outre, je ne déplorerais pas sa disparition si elle ne change pas de visage. Ca n’a pas grand chose à voir avec l’art, car il n’agit en ce cas qu’en qualité de révélateur, même s’il peut suggérer des « solutions ». Maintenant, il ne faudrait pas en faire son unique fonction, si l’artiste peut être en partie chroniqueur de tous les désastres, l’inverse est impossible. Le « Cassandre » de notre civilisation sera dans le meilleur des cas un littérateur, en aucun cas un artiste. Il s’agit à nouveau des notions de contenu et de contenant, l’art peut contenir la littérature, la littérature si elle n’est pas de la poésie, ne peut appartenir à l’art ( Ce qui ne diminue en rien sa valeur ni sa portée.). Je veux dire que si l’artiste est un artisan, l’artisan n’est pas forcement un artiste.
Cette discussion est passionnante, mais elle ne nous mène pas très loin. Si je peux me permettre, nous tournons en rond. Venons-en plutôt à votre pratique, disons, à ce qui fait sa spécificité. Vos nus, vos portraits, vos paysages, vos natures mortes, nous l’avons tous déjà vu. La façon que vous avez de traiter ces sujets, depuis longtemps, d’autres l’ont fait avant vous, et mieux que vous, sans vous offenser.
Vous n’êtes pas très indulgent, mais vous avez raison et par là même vous ne m’offensez en aucune manière. Avant de faire du neuf, me semble-t’il, il convient de connaître le vieux, de le pratiquer sur le fond. Qui n’a pas tenté de plagier Balzac ne peut écrire. Selon Lucien Rebatet, Dvorack est un pâle imitateur de la musique allemande, n’en est-il pas moins un grand compositeur ? Je ne fait que ce que je peux, avec les moyens qui m’ont été donnés. Je ne suis pas un génie et je ne vais pas renouveler l’art de peindre de fond en comble, je ne suis pas non plus un saint pour indiquer aux hommes la voie du salut. Mon métier, mon ministère, pour dire bêtement la chose, est de prononcer le plus clairement possible ce qui devrait être évident pour tous (et pour moi-même), de manière à ce que cela soit convenable, à ce que l’on appréhende mieux notre condition. Voyez les prétendues interprétations de l’art nègre par Picasso, ce ne sont en fait que de pures copies de statuettes protohistoriques Basques volées et dont il était receleur. L’art de Picasso est celui de la virtuosité, une manière de présenter qui touche au sublime, qui sublime l’objet donné au spectateur. S’il fait resurgir dans notre ère ce qui n’appartenait qu’à un passé plus qu’oublié, ce n’est pas qu’il l’invente, ni qu’il le façonne à sa -notre- manière, il obéit et remonte à la surface ce qui faisait l’humanité et qui voudrait le faire encore. Malevitch, puisqu’il est Russe, ne s’est pas trompé, un autre exemple d’abstraction (démente celle-là !) il suivait le folklore de sa nation. Chez beaucoup de peintres, il s’est agit de régression, chez Malevitch ou Picasso, ce fut perpétuer, donc renouveler. Chacun des deux, comme il put, avec excellence, donna une postérité à la grandeur de sa nation, de sa patrie, la rendit plus grande et plus belle, et plus proche de nous autres, qui ne sommes ni russes, ni espagnols.
Vous dites que le but de la peinture est universalisation, franchir les frontières, transgresser le temps et l’espace, se donner à tous sans distinction de classe ni de race ; vous n’êtes pas très pragmatique.
Je ne parlais que de nations, ni de races, ni de classes.
Vous considérez donc que certaines nations, races ou classes, n’ont pas accès à l’art, à la culture, de par leur naissance ?
D’une certaine manière, oui. J’ai lu que De Chirico différenciait les peintures italienne et française en disant que l’une procédait de l’arcade, tandis que la deuxième serait de la lucarne. Effectivement, j’ai toujours préféré enfermer mes sujets, peindre des fenêtres plutôt que « de vastes portiques ». J’aime quand la lumière provient, j’aime les grandes étendues si le ciel est bas, les limites plutôt que l’horizon infini, les lignes de fuite interrompues, brisées. Dans ce que je fais, le derrière n’est pas au fond, mais dedans ; pas loin à l’infini, mais à l’intérieur et devant. Je trouve fascinante la perspective de certaines peintures asiatiques où le point de fuite est devant, ce qui place le spectateur derrière l’œuvre, pour ainsi dire à l’intérieur, en un simple tour de prestidigitation, seulement parce qu’une table est dessinée à l’envers ; comme dans la buveuse d’absinthe de Degas avec sa table sans pied. Ces subterfuges, la main à six doigts de Chagall, tournent notre marche « en arrière et non en avant », comme dirait Lautréamont. L’icône dite du peintre Théodore, qui représente Abraham dînant avec les Anges - et au-delà la Sainte Trinité -, use aussi de cette méthode, pour des buts plus élevés…
Vous êtes un intimiste. On dirait que vous ne voulez pas montrer vos œuvres à tout le monde, mais seulement que chacune d’entr’elles trouve son destinataire et ne soit comprise que par lui, par lui seul, bien que d’autres puissent la voir ?
J’ai horreur de la foule. Je trouve l’atelier de Courbet angoissant, tout ce monde ! Comment peut-il travailler correctement avec tous ces gens chez lui ? J’ai bien assez de tous les fantômes qui jugent chacun de mes gestes lorsque je peins ! Je peux me figurer, avec quelques grammes d’alcool dans le sang, dessiner un modèle ou le portrait d’un individu présent physiquement, mais peindre.. ah, ça, non ! ! ! J’éprouve de grandes difficultés à me concentrer si je ne suis pas seul. Vous constatez d’ailleurs qu’en vous répondant, ma réflexion n’atteint pas des sommets de profondeur, si je puis dire. Je déteste la promiscuité et l’instantanéité, la présence physique d’un seul être, d’un seul autre, me perturbe irrémédiablement, répondre du tac-au-tac à vos questions est un supplice. Je pense qu’il en est de même pour mes travaux : je préfère finir dans les livres que dans les musées, du moins tels qu’on les présente. Un dialogue est plus fructueux qu’une conférence, du moins si je la donne. Nietzsche disait que « l’ami est toujours le troisième, celui qui empêche la conversation des deux autres de tomber dans les profondeurs.». Je crois qu’en regardant une peinture, comme en la faisant, on doit être seul, parce qu’il ne s’agit pas de communion, mais d’un dialogue avec soi-même, d’un discours vivant. Ezra Pound dit qu’un tableau est fait « pour durer, pour vivre avec »… que dire de plus ?
Pour l’instant, pas grand chose. Citer la fin du poème ?
« Ils ont amené des putains à Eleusis
Des cadavres prennent place au banquet
Sur mandement de l’usure. »
J’ai éteint mon magnétophone sur nos éclats de rire. De ses amis étaient arrivés, peu à peu, ce qui explique la légèreté de ses dernières réponses et les poses de dandy qu’il prenait, cette manière hautaine qu’il avait de me dévisager, tête renversée, les yeux mi-clos, le rictus dégoutté et le menton italien, qui exprimaient plus de lassitude que de réel mépris. A la suite de quoi nous avons mangé des œufs farcis à la crème de chèvre avec du riz froid, puis des côtes de porc panées au four accompagnées d’un gratin de pommes de terre, le tout arrosé d’un Hautes Côtes de Nuit, couronné par un plateau de fromages de lait cru et achevé avec un Gin efficace que Laurent James avait porté ; une de ces soirées mémorables dont on ne se souvient plus, tissée de conversations indescriptibles, de mâle camaraderie, de fraternités exquises, de gaieté amnésique et franche liberté, où le monde se détruit plus qu’il ne se refait.
« Rien n’est plus naturel ni plus raisonnable
que d’avoir beaucoup de vénération pour toutes les choses
qui ayant un vrai mérite en elles-mêmes,
y joignent encore celui d’être anciennes. »
Charles PERRAULT ; (Parallèle entre les anciens et les modernes)
Manchester, 27 janvier 2005.